
Les
50 ans de Bandoeng;
le
non alignement à l’ère du supraimpérialisme
-Avril 2005-

Immeuble où se tint la conférence historique de Bandung 1955. http://www.geocities.com/bandungcity/aa.htm
Dans un discours à Colombo Ceylon en 1954, le dirigeant indien Nehru aurait forgé les termes «non-alignés».
Nehru face à la
foule. Photo Encarta
« Bandoeng a proclamé l’émergence sur la scène internationale de plus de la moitié de la population mondiale» clame un an plus tard le pandit Nehru à l’issue de la conférence de Bandoeng. Le président Senghor qualifie la rencontre de moment « le plus important depuis l’époque de la renaissance»[i]. Les cinq pays du groupe de Colombo (Indonésie, Inde, Ceylan, Birmanie, Pakistan) qui en avaient été les initiateurs ne pourraient qu’être fiers des retombées de cette conférence afro-asiatique. Elle fut le tremplin du non-alignement, un concept et une politique en réponse à la bipolarisation mondiale et qui lui a laborieusement survécu.
Le monde d’alors se relevait à la fois meurtri du second conflit mondial, et fracturé en deux blocs idéologiques: l’Est et l’Ouest. L’URSS escomptait que tous ces pays, qui en voulaient à la colonisation et à l’impérialisme, seraient à sa remorque dans son camp en rupture avec le capitalisme. L’Ouest, le monde dit libre, maître contesté de l’essentiel de l’espace en décolonisation, s’ingéniait à s’y reproduire et faisait valoir que la reconstruction du plan Marshall légitimait sa croisade du développement style «Big Push» et «Take off». Ces paradigmes s’enracinaient déjà à l’ONU et ses institutions spécialisées. L’institutionnalisation du système multilatéral qui choisit d’assurer la reproduction internationale de l’ordre mondial, et les contradictions des accessions aux indépendances ne firent que raviver la bipolarisation.
Le vent de décolonisation, amorcé déjà avant le second conflit mondial, colportait néanmoins toujours le rêve des élites des nouveaux Etats et leur aspiration à la souveraineté et au développement. Ceux qui avaient obtenu l’indépendance, et ceux qui l’attendaient de manière imminente savaient que cette victoire politique devait être parachevée par la libération économico- sociale et culturelle. Et pour ce faire, il y avait une relative unanimité de vue sur le rôle dirigeant de l’Etat en la matière. Même ceux qui optaient pour le capitalisme le concevaient. Les conceptions néo-classiques de la main invisible du marché, en vogue aujourd’hui, étaient marginales d’autant plus que dans la reconstruction des économies d’après guerre, l’Etat joua un rôle majeur. Aussi ces théories n’avaient aucune prise réelle sur ceux qui aspiraient à l’indépendance. La majorité des jeunes Etats voulaient croire à l’intégration dans le capitalisme, mais la plupart d’entre eux ne voulaient pas d’une quelconque forme de néo-colonialisme, fut- il avec un nouveau parrain. D’autres acceptent de nouvelles alliances subordonnées ou la poursuite de l’allégeance, en participant à la tentative de containment du socialisme et en offrant de géo-stratégiques bases et accès aux ressources naturelles aux parrains. Une minorité ose rejeter ce marché et de fait s’était associée au bloc de l’Est et malencontreusement reproduit ses erreurs de développement. Dans les faits, ils furent rares ces régimes radicaux qui osèrent s’allier à l’URSS. Les autres qui ne lui étaient que sympathiques, ne basculèrent pas dans son camp. Mais ils en devenaient objectivement membres pour l’Ouest qui les bouda et les combattit en retour. Ces lignes de fractures firent qu’il y eut, dès le départ, une adhésion massive au concept de non alignement si attrayant par son accent de neutralisme progressiste.
Politiquement, être non-alignés s’avérait tout aussi important pour ceux dont la nation existait que ceux où elle n’était pas encore cristallisée. Dans la réalité matérielle, au-delà de cette unanimité politique, une autre plus grande les unissait. Les jeunes Etats aspiraient tous au développement perçu innocemment comme technique, neutre et susceptible de générer la modernité, le progrès. Bien peu se préoccupaient du potentiel prédateur et destructeur du développement, et objectivement au fond, les antagonismes Est-Ouest, Nord-Sud ou non alignés importaient peu, en autant que ces aspirations soient enfin atteintes. Au fil des ans, malgré la dispersion des itinéraires, la cohésion du principe non-aligné s’est maintenue, malgré les lignes de fractures des alliances avec les blocs. Elle a permis le groupe des 77, la tricontinentale, un plaidoyer relativement cohérent avec les collectives aspirations pour un autre ordre économique mondial dans les instances multilatérales. Puis un grand essoufflement a commencé dans les années 80, suivi d’une traversée du désert. Aujourd’hui, un frémissement de relance du mouvement tiers-mondiste est observable, principalement en réaction à la mondialisation néo-libérale.
Cinquante ans plus tard, l’échec et/ou le succès bien discutables de quelques exceptions de développement et de non alignement, nous obligent autour de la célébration de cette rencontre historique, de revenir sur la genèse du mouvement non-aligné.
Il nous faut voir ensuite ce qui
en reste, maintenant que s’instaure un nouvel ordre mondial. Ce dernier,
qualifié de mondialisation, correspond à un brutal redéploiement du
capitalisme, juste quelques années avant l’implosion du bloc de l’Est et la
chute de l’apartheid. Cette extension et reproduction capitaliste, caractérisées
par un enrichissement et un endettement démesurés aggravent la polarisation du
monde. C’est dans ce contexte que s’impose la prétention unipolaire qui
proclame TINA (there is no alternative).
Pas d’alternative à un nouvel ordre bloqué sur la rationalité marchande et
son darwinisme socio-économique et politico-culturel.
Ce semblant d’ordre impérial dans un « village global» prétendu,
qui escompte de tous leur alignement, nous l’appelons le
supra-impérialisme du mégaloensemble[ii]. Contre cette sorte d’apartheid
mondial, et malgré la dispersion de trajectoires et des non-alignements tentés,
l’essentiel de l’humanité compte, objectivement plus que jamais, sur ces
valeurs acentriques, universelles et toujours potentiellement porteuses qui ont
fleuri à Bandoung.
Au sortir du premier conflit mondial, les revendications égalitaristes des conscrits du tiers monde ont très vite été repoussées par les prétextes de la reconstruction de l’Europe détruite. Les soldats d’Afrique et d’Asie se sont combattus ou ont fraternisé sur les champs de bataille. Certains se sont imprégnés de valeurs libertaires de la révolution des soviets, de mouvements qui tentaient ailleurs de faire éclore des espoirs similaires. D’autres ont raffermi leurs liens avec les syndicats. Il en a résulté qu’avait été démystifiée la supériorité coloniale, sans que pour autant l’aliénation et les complexes d’infériorité ne s’estompent réellement au sein des élites. En 1920, au second congrès de l’internationale communiste, est abordée la possibilité, pour les pays dits retardataires, de passer au socialisme sans le détour du stade capitaliste. Nath. M Roy, qui y soutient une ligne contraire, est donc accusé de gauchisme et la vision de Lénine s’impose.
Lénine leader de l’URSS
Photo LaRZKP9HmTgJ:alain
C’est sans surprise que la prétention léniniste de transcender la phase capitaliste, et atteindre par une voie non capitaliste le socialisme, se perpétue au IV, et V congrès. Cette conception aura beaucoup d’influence dans le courant socialisant des futurs pays périphériques. Dans les faits, pour la III ème internationale ou Komintern, la prétention de réunir les forces anti-impérialistes, anticolonialistes et révolutionnaires dans un sursaut fraternel sera freiné par l’avènement de Staline à la tête de l’URSS.
Staline
Photo coranix.
Staline fera passer désormais tout après l’intérêt de l’Etat soviétique. Ainsi au VI ème congrès du Komintern de 1928, la volonté de lutte anti-coloniale des révolutionnaires des pays dominés est dénigrée et déclarée contre-révolutionnaire. L’essentiel se serait borné à abattre le capitalisme qui emportera dans son sillage son avatar le colonialisme.
C’est donc ailleurs qu’il faut chercher, le creuset de Bandoeng. Probablement au congrès de la ligue contre l’impérialisme de Bruxelles en 1927, avec Lamine Senghor, Gorki, Nehru, Messali Hadj, Einstein… C’est là que se mirent en rapport des nationalistes africains et asiatiques et des progressistes européens déjà en attitude ambivalente à l’égard du Komintern. Au fil des années se raffermirent des liens, alors que la reconstruction des économies détruites et la reprise à maintenir repoussaient les échéances de la souveraineté.
L’embellie économique et la spéculation capitaliste eurent tôt fait de faire basculer le monde dans la crise de 1929. Ce fut un second prétexte pour repousser l’échéance de desserrer le corset colonial et éloigner une fois de plus les perspectives de souveraineté. Le négus Haïlé Selassié, devant la montée du fascisme, mit en garde, en 1935, les membres de la SDN- société des nations- de l’impératif de défendre la souveraineté. Il ne fut point écouté.
Hailé
Sélassié
Photo affellem/gifs.html
Le banc d’essai internationaliste que fut la guerre d’Espagne et surtout l’horrible épreuve que constitua la seconde guerre mondiale vont permettre de rapprocher objectivement les vues des nationalistes progressistes des pays colonisés. La lutte contre le nazisme, sera un outil commode pour retourner le discours anti-fasciste contre le racisme colonial, alors que les lézardes de l’édifice colonial apparaissaient partout béantes. Mais les tenants du l’ordre imposèrent Yalta, en février 1945.

Les alliés à Yalta.
http://encarta.msn.com/media_461522741/Allied_Leaders_at_Yalta.html
A Yalta s’instaure une division tragique du monde pour les colonisés. Voilà que tous ceux qui aspiraient à la dignité, à la souveraineté et au développement devaient choisir des sentiers d’émancipation gangrénés par la bipolarisation. Roosevelt sort de Yalta confusé Mais il tient sur son chemin de retour à rencontrer Farouk d’Égypte, Hailé Sélassié d’Éthiopie, et Ibn Séoud d’Arabie. Une diplomatie pour monarques cooptés, mais surtout privilèges à des exceptions indépendantes qui pourraient servir de modèles aux autres. Roosevelt meurt peu après, et Truman qui le remplace est plus volontariste. Certes l’avènement de l’ONU apportait le gage d’un nouvel ordre fondé sur le droit et l’autodétermination.
Mais les instances de Bretton Woods, le plan Marshall et Mac Arthur favorisaient surtout le bloc de l’Ouest et la portion de l’Asie domptée. L’Amérique toujours ségrégationniste en son sein considérait le centre et le sud de son hémisphère comme sa zone naturelle d’influence. Les métropoles européennes tentaient-elles vainement de retenir la bride indépendantiste ou de la coopter en Afrique. Quant au Kominform qui s’instaure à l’Est, il laissait peu d’espoir de soutien réel, au delà du discours mythique de l’internationalisme prolétarien, aux colonisés ( quoique maints mouvements de libération n’auraient pu concrétiser leur lutte sans le soutien de Moscou).
L’Inde, dès le lendemain de la seconde guerre mondiale, esquisse alors les termes d’un refus à un quelconque alignement. Elle élabore les fondements de l’option afro-asiatique mûrie depuis la conférence de Bruxelles. En 1947 à New Delhi, une conférence réaffirme le droit à la souveraineté, et la lutte de libération nationale. Deux ans plus tard, à la répétition du même événement, se joignent au premier groupe des 12 pays asiatiques et arabes, le Libéria et L’Éthiopie. La période est déjà turbulente. Ho chi Minh avait proclamé unilatéralement l’indépendance du Viet Nam, deux ans plus tôt, ce qui exacerba la lutte. La Palestine et l’Égypte secouent le joug britannique, et ne peuvent empêcher l’avènement d’Israël. La Chine, le pays le plus peuplé du monde, vient de gagner sa guerre de libération et bascule dans le communisme en 1949. En Amérique latine, en 1952 la révolution bolivienne, et suivie deux ans plus tard d’une autre au Guatemala. Truman prononce alors son fameux point IV et inaugure officiellement l’ère du développement. C’est désormais partout la conceptualisation du sous-développement, et le rôle que s’arrogent les tenants de l’ordre mondial pour l’éradiquer. Pendant ce temps, l’Indochine s’enlise dans sa lutte de libération et la guerre de Corée éclate. Celle ci a un effet de catharsis pour le futur mouvement des non alignés. Car la Chine et l’URSS aussi s’y activent, et les États-Unis façonnent un chapelet d’alliances militaires régionales cooptant des pays de la zone, du Japon aux Philippines. Les relations internationales sentent le soufre et les grandes puissances accumulent leur arsenal nucléaire.
Champignon nucléaire. Encarta
L’OTASE et le plan de Bagdad accélèrent la cooptation militaire de l’Asie. Pendant ce temps, l’URSS louvoie entre soutiens aux mouvements de libération nationale du tiers Monde et atouts stratégiques.
C’est donc de Belgrade, qui déjà en 1950 à l’ONU recommandait un fonds spécial des Nations Unies pour le développement, que viendra le soutien réel aux colonisés. Autant militaire qu’idéologique, ce soutien est personnalisé par Tito. C’est un camouflet à l’URSS, qui hormis sa puissance industriel et militaro-scientifique, demeure un vaste pays ayant certaines caractéristiques similaires aux autres. C’est ce qui la pousse à vouloir devenir membre du mouvement en formation. Ce n’est donc pas d’elle, mais de Nehru, Soekarno Nasser et Tito que dépendra l’architecture du vaste mouvement des non alignés. Il n’y a pas d’appellation pour désigner l’immense ensemble qui aspire à la paix et à l’indépendance. Sauvy, un démographe Français, en référence au tiers état de la révolution française, forgeant en 1952 le mot Tiers monde écrit: «…le monde numéro un pourrait-il, même en dehors de toute solidarité humaine, ne pas rester insensible à une poussée lente et irrésistible, humble et féroce vers la vie. Car enfin ce tiers monde ignoré, exploité, méprisé, comme le tiers état, veut, lui aussi, être quelque chose»[iii]
Terme globalisant et à la fois réducteur, Tiers monde connaîtra une fortune réelle. Il sera brandi comme un étendard, alors qu’il représente en les nommant mal les ¾ de l’humanité. Ainsi prenait forme, avec la signature entre Tito et Nehru en 1954, une politique de non-alignement active et constructive du Tiers monde, pour édifier la paix et la sécurité collective, hors des puissances antagoniques. L’accord de coexistence pacifique entre la Chine et l’Inde en 1954, la signature du pacte de Bagdad entre la Turquie et l’Iraq, comme la défaite de la France en Indochine, obligent très vite Nasser à choisir définitivement son camp et à se joindre à Nehru et Tito, afin de consolider la politique de non- alignement prônée par l’Inde.

Soekarno, que les Hollandais détestaient et qu’ils accusaient de connivence avec les Japonais, était désormais au commande de la jeune Indonésie, devenue modèle pour tous les peuples ayant soif de liberté. C’est pourquoi, lorsque le quintet de Colombo y convoque sur l’île de Java en 1955 la conférence de Bandoeng, le tremplin était irréversiblement dressé pour le mouvement des non alignés. Il deviendra, après celui de l’ONU, le plus grand forum des pays en développement ( 114 le composent).
Non-alignement Monuments, les bustes de Nasser, Tito, Nehru, Nkrumah dans un petit jardin de la Georgetown la capitale de la Guyane ou se tint le sommet de 1972; le monument au carrefour de Simpang Lima à Bandoung et le mémorial de la conférence de Bandoung à Beijing semblent être les rares monuments à la mémoire des illustres fondateurs. Pour la Chine ce fut là le premier évènement multilatéral de la république populaire.

Le monument Asie Afrique au carrefour de 5 rues au bout de l’avenue qui porte
le même nom à Bandoung.
La ville de Bandoeng existe au moins depuis 1488. Les paysans sundanais auront vu y défiler les aventuriers et colons européens rivaux. Louis Napoléon, qui dirige aussi la Hollande, y intensifie le réseau d’infrastructures et fortifie ses défenses contre les Anglais en 1809. Au 19 ème siècle y sont introduits la culture de la quinine (essentielle aux expéditions militaires si exposées à la malaria), celles du café, du thé. Le boom économique et l’extension des réseaux ferroviaires y drainent une main d’œuvre chinoise qui resta. En 1906, une administration civile hollandaise remplace la militaire. La période du second conflit mondial permet aux citoyens de la ville de prendre davantage contrôle de leur ville. Juste à la fin du conflit, la révolte y gronde et les insurgés dirigés par Soekarno et Hatta proclament l’indépendance. Devant ce fait accompli, la riposte militaire hollandaise est massive et musclée. Déterminés à créer un Commonwealth néerlandais, malgré la désapprobation onusienne, les pays Bas, qui obtiennent de la Banque Mondiale dans la même époque un prêt de 195 millions de dollars, s’entêtent.[iv] Mais la perspective de voir s’y redéployer l’administration hollandaise poussa les citoyens à mettre le feu à leur ville. Ce fut Bandoeng Lautan Api, Bandoeng l’océan de feu. C’est sur ses cendres que se confirme l’indépendance du pays avalisée par l’ONU, alors que les Pays-Bas se rabattront sur la Nouvelle-Guinée où ils s’éterniseront jusqu’en 1963.
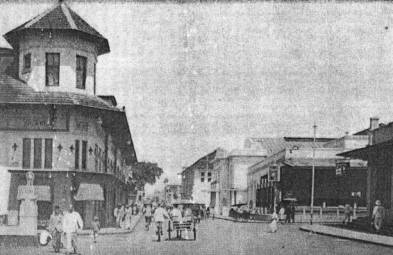
L’avenue de 1935 qui sera rebaptisée Asia Afrika Street
http://www.geocities.com/bandungcity/aa.htm
On comprend que dans cet endroit symbolique, les rivalités et conceptions idéologiques hétéroclites se turent un moment, pour proclamer l’esprit de Bandoung. Soekarno y dépeignit le colonialisme comme «..un ennemi habile et décidé qui se manifeste sous divers déguisements ; il ne lâche pas facilement son butin. N’importe où, n’importe quand, et quelle que soit la forme sous laquelle il apparaisse, le colonialisme est un mal qu’il faut éliminer de la surface du monde»[v]

Bandoung fut un hymne à
la décolonisation et à la coexistence pacifique, écrit et entamé par les 29
colonisés et jeunes Etats libres qui unanimes dans leur déclaration finale
s’accordaient
- «pour déclarer que le colonialisme sous toutes ses formes est un mal auquel il doit être rapidement mis fin
- pour affirmer que la soumission des peuples au joug étranger, à l’exploitation étrangère, constitue une violation des droits fondamentaux de l’homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et est un obstacle à la consolidation de la paix mondiale».
Ils déclarent 10 principes :
Derrière l’unanimité de façade, la lutte de décolonisation et les manœuvres des puissances autant bi-polaires que métropolitaines, tout comme les aspirations des élites, fragmentaient l’alliance. Malgré leur brouille larvée Chine et Viet-Nam penchaient vers l’URSS ; le Pakistan et la Turquie lorgnaient vers l’Ouest. Seules l’Inde, l’Indonésie et l’Égypte étaient conséquentes avec le non- alignement. Dans l’euphorie du moment, on pouvait quand même percevoir les alignés potentiels, les neutralistes, les communistes non alignés, les nationalistes anticommunistes ou plus libéral protectionnistes. Alors que le trio fondateur savourait sa victoire et polissait ses différences en 1956 à Brioni, le véritable test du non alignement et de la souveraineté allait se jouer dans l’année même.
La nationalisation du canal de Suez démontre en effet que rien n’était joué quant au non alignement. Par contre, il sonne le glas du vieux système colonial sommé de s’ajuster aux exigences du renouveau impérialiste. L’Europe devait au plus vite, éteindre ses brasiers et procéder à des indépendances négociées pour coopter les nouveaux régimes naissants. La bi-polarisation allait quant à elle surdéterminer tout le champ politique des nouvelles formations sociales. Seules les luttes armées de libération nationale entretenaient un potentiel révolutionnaire comme à Cuba, mais ne pouvaient s’extraire de l’attraction gravitationnelle bipolaire. Le secrétaire général de l’ONU meurt de manière suspecte au Congo, tout comme s’étiole le rêve de souveraineté et du panafricanisme avec l’assassinat de Lumumba.
Dag Hammarskjöld sec. Gen
ONU. Encarta.
Le chapelet d’indépendances n’augure pas de souverainetés réelles. Les blocs militaires se succédaient partout. OTASE, CENTO, ASPAC, ANZUS en Asie; contraignants accords de défense et de coopération militaire entre les anciennes puissances tutélaires et les jeunes Etats proto- nations en Afrique; luttes anti-révolutionnaires et pactes contre-insurrectionnels en Amérique Latine. Que de fausses notes à l’hymne Halo Halo Bandung symbole des non-alignés.
L’essor et la croisade des non-alignés
Pour consolider le fragile acquis politique des indépendances, la conférence des non alignés du Caire de 1962, esquisse les termes d’une coopération essentielle entre le Nord et le Sud, au niveau économique. Cela permettra l’avènement, deux ans plus tard, de la CNUCED. L’ordre international s’avère de plus en plus pervers pour ces formations sociales périphériques. Certes, à sa faveur se dispersent, dans le prétendu Tiers monde, des itinéraires, selon que l’on dispose de certains atouts pour être intégré favorablement dans le marché mondial. Naturellement donc, les préoccupations du mouvement des non alignés se focalisent sur le dialogue Nord Sud. Ce fut davantage, et cela le demeure d’ailleurs, un monologue du Sud.
La
tentative d’un front tricontinental anti-impérialiste échoua en 1966 à la Havane.
Graduellement le mouvement est
cependant parvenu, par ses pressions, votes collectifs et résolutions, à faire
émerger une seconde et une troisième génération des droits de l’homme. À
défaut d’avoir participé à rédiger la première déclaration des droits de
l’homme et à y insérer leurs équivalents homéomorphes, c’est déjà une
victoire pour les jeunes pays. En 1969, l’assemblée générale de l’ONU
adopte la résolution 2542 « Déclaration sur le
progrès et le développement dans le domaine social». Elle élargit le
domaine de la sphère économique à d’autres pans du social notamment en
terme de droits de l’homme et de justice sociale. Dans les faits, la plupart de ces nouveaux droits et
conventions ne sont pas assortis de devoirs et restent lettre morte. La conférence
de Lusaka en 1970 introduit en plus des habituelles questions politiques les impératifs
économiques de façon plus revendicative. « Stratégie pour la Deuxième Décennie des Nations
Unies pour le développement» dans la résolution 2626 de 1970 traduit
amplement les aspirations du mouvement.
Dès 1973-74, l’échec pour obtenir un NOEI (nouvel ordre économique international) et un NOMIC ( Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication), sonne le réveil du rêve petit bourgeois de Bandoeng. Les demandes, relayées par le groupe des 77, étaient pourtant compatibles avec une intégration dans l’économie mondiale. Elles réclamaient entre autres, une intégration dans le marché mondial, mais avec des règles du jeu plus harmonieuses; la stabilisation des prix des matières premières; des codes de conduites pour les firmes multinationales; la levée des restrictions commerciales; une correction des termes de l’échange inégal; tenir la promesse des 0,7% à la coopération internationale non conditionnée; et le renforcement du pouvoir des pays non alignés au sein des institutions onusiennes.
L’échec de mettre en œuvre ces mesures, et qui reviennent encore comme des leitmotiv, a contribué à dévoiler et à amplifier l’émiettement du front tiers mondiste. Ces rencontres se sont alors muées en kermesse institutionnalisée, un peu désabusée par l’impuissance à transformer efficacement l’ordre mondial.
Dans cet émiettement, deux groupes pour l’instant parviennent à se faire respecter moindrement par les tenants de l’ordre mondial. D’abord la périphérie utile, une quinzaine de pays émergents, subalternes et industrialisant pour la mondialisation. S’y démarque un premier groupe des pays capitalistes de l’Asie de l’Est (Taiwan, Corée du Sud, Hong Kong et Singapour) et du Sud-Est (Malaisie, Thaïlande). A l’instar de la Chine, ils ont maintenu un fort taux de croissance, mais s’en sont différenciés par d’autres stratégies de plein emploi et de formation professionnelle, d’interventionnisme étatique; d’épargne et d’investissement, de dynamisme entrepreuneurial alliant culture famille et capital; d’intégration régionale et d’importantes sollicitudes extérieures. Depuis la crise économique qui les a frappé en 1997, de nouveaux problèmes sociaux y ont fait surface.
Viennent ensuite des pays comme l’Inde et quelques exceptions latino-américaines ( Brésil- 8 ème économie mondiale-, Mexique) qui ont pu se doter d’un tissu industriel et qui sous-contractent des portions de biens et services du marché mondial. Le G20 défend principalement la place des pays émergents dans la mondialisation.
Viennent enfin les formations sociales, toujours captives de la division internationale du travail qui, malgré son évolution, les cantonne dans un rôle de fournisseurs de matières premières. Il s’agit de l’essentiel des pays arabes et d’Afrique. Malgré parfois quelques unités industrielles compétitives, ils ne parviennent pas à influencer la marche économique du monde et en subissent pratiquement passivement davantage les contrecoups, y compris même lorsqu’ils sont producteurs de pétrole. Beaucoup de ces pays ont perdu jusqu’ à leur statut déjà peu enviable de périphéries. Illustrations de la dévastation de l’expansion capitaliste, ils sont devenus des zones excentrées et /ou des mis en réserve.[vi] De plus en plus enclins à négocier une cooptation compradore, ils sont laissés en pâture à l’instrumentalisation du désordre de firmes secondaires et de pouvoirs politiques prébendiers excellant dans le maquillage démocratique. Pour eux on a réchauffé les besoins essentiels de Perroux, soit les objectifs de développement du millénaire. Ils ont peu de chance d’être atteints d’ici 2015. Les trois décennies de développement décrétées par l’ONU n’ont-ils pas été globalement des échecs, malgré des avancées spectaculaires dans plusieurs domaines.
Décennie d’errance où le développement sous perfusion par des prêts concessionnels est vite abandonné, lorsqu’on passe en 1973 du taux d’étalon or aux taux flottants. La chute du dollar qui s’en suit va grever les revenus d’exportation de ces pays dont l’essentiel des produits sont négociés en cette devise. L’action des pays de l’OPEP conduira à un redéploiement de crédits vers les pays non- alignés appâtés par le slogan « acheter aujourd’hui payer demain», si important pour éviter la crise de surproduction des pôles avancés. Ils se sont très vite endettées et engluées dans les intérêts de cette dette. Une dette aussi due à l’enrichissement illicite d’élites qui rapatrient au Nord bien de leurs avoirs. Des avoirs qui emboîtent le pas au transfert de ressources, de biens et de fonds. Ceux ci sont toujours supérieurs aux flux d’aide internationale, d’ailleurs bien mal nommée.
Au début 80, la récession au Nord entraîne la déliquescence
de l'État providence, la hausse des taux d’intérêt et la morosité économique
au sud. Le paiement de la dette et la nécessité d’accéder à d’autres crédits
cèdent le pas aux ajustements structurels. Ils augmentent certes la production,
mais sont en passe d’achever les malades. Les cures d’assainissement
aggravent la paupérisation.
|
Personnes
vivant avec moins d'un dollar par jour |
|
|
ACDI. Canadiangeographic.ca
Dans les années 90, on s’acharne à accroître la productivité des pauvres et à reconfigurer l'État, en laissant le privé prendre les commandes de l’essentiel. La société civile est cooptée à ce service et la governance est appelée à la rescousse, comme dimension politique des ajustements, afin d’éviter que les États ne persistent à contourner les mesures draconiennes. Ces dernières tissent la révolte, au point de voir depuis deux ans les tenants de Davos récupérer le discours alter mondialiste et desserrer l’étau de la dette. En même temps, les derniers bastions du bien commun sont investis par la rationalité marchande (de l’eau aux plantes, de la culture aux gènes…). Tout cela exacerbe l’exploitation du travail. Compte tenu des différences de rémunération et de productivité par rapport aux pays avancés du centre, elle occasionne vers ces derniers toujours davantage de transferts de capitaux et de main d’œuvre sélective. Parallèlement, -par les zones de libre échange et autres formes d’intégration, de l’Union européenne à la ZLEA ou au NEPAD[vii]- la mondialisation procède à un laminage autant des économies des pôles dominants nationaux autocentrés des centres capitalistes, que ceux des pôles dominés qui n’ont pu s’autocentrer. Elle les recompose en réseaux productifs mondiaux intégrés mais concurrentiels. A tous les autres de les imiter et de s’aligner à cette logique ou de péricliter. Et ce n’est pas les initiatives de coopération Sud /Sud pourtant prometteuses, qui les en empêchent.
Quelle
souveraineté ou l’alignement de tous devant l’Un
À l'équilibre de la terreur de la guerre froide, nous voyons se substituer la terreur du déséquilibre. Déséquilibre qui est celui de la mondialisation et de ses contestations. C'est un déséquilibre précaire, générateur de chaos, d'illusions et, à long terme si la tendance se maintient pour l'humanité, d'anomie.
Dans la mondialisation néo-libérale, le terme de supra-impérialisme pourrait caractériser la phase nouvelle que tente d’imposer le capitalisme effectif. Ce supra-impéralisme (supra, du latin au-dessus, plus haut ) désigne les extensions multiformes de l’espace du capital dans lequel différents vecteurs oligopolistiques tentent d’infléchir l’économie mondiale. A titre d'illustration, le fait qu’une dizaine d’entreprises contrôlent quasiment la moitié du marché mondial. Ou que 350 les plus riches du monde accaparent un revenu égal à celui de 2,6 milliards de personnes. Cette mondialisation est une inflexion dans le sens de la construction d’un système monde particulier, que je nomme le mégaloensemble. Un système Monde, surestimant sa capacité et sa grandeur, et dont l’orgueil délirant, surfant sur des capitaux fictifs, bénéficie en priorité aux grandes entreprises et banques des premières puissances étatiques. Ces acteurs jouissent en premier lieu du marché des biens, services et capitaux, au détriment de la réalisation des droits économiques sociaux et culturels collectifs. Le marché mondial en restructuration par l’OMC qui conforte le statu quo peut très bien nous mener vers une impasse.

http://bellaciao.org/fr/IMG/jpg/omc2.jpg
Les 200 plus grandes entreprises, qui ne fournissent de l’emploi qu’à 0, 75 de la force active dans le monde, accaparent le quart du PNB mondial[viii]. Les transnationales monopolisent les transactions internationales du commerce. La moitié de ce commerce se déroule strictement entre elles. La dominance dans la mondialisation est donc la financiarisation de l’économie. Il est vrai que le caractère évolué du niveau de technologie, d’information et de communication font revêtir à cette mondialisation néo-libérale un caractère sans précédent. Mais le processus n’est pas achevé et la mondialisation ne pourra s'arroger le titre de changement social. Ce dernier l'a précédé et lui survivra probablement. Issue de l’oligopolisation du processus transnational, alimentant les rythmes des percées technologiques et scientifiques tout en y étant assujettie, la mondialisation est un sursaut qualitatif de l’économie monde. Mais nulle part, elle ne procède à l’égalisation des chances et des économies. Au contraire, partout elle creuse et polarise les écarts. Il s’agit dès lors d’un processus polarisant par essence, parce que asymétrique et biaisé par les pouvoirs dominants dans les centres animés par la nécessité d’instaurer l'ordre supra-impérialiste. Cela aux fins de l'exploitation des richesses du globe à leur profit.
Partout pratiquement, beaucoup de ces classes dirigeantes disent oui à cette transnationalisation, parce qu'elles en sont avant tous les premiers bénéficiaires en terme de richesse, de prestige et de pouvoir. Les peuples sont les premières victimes de cette transnationalisation débridée. Même le développement durable a été récupéré par cette mondialisation, et au fond, l’équation devrait être celle d’un développement endurable!
L'uniformisation et l’homogénéisation du monde que fait miroiter la mondialisation restent une tendance. Le système mondial ne peut assurer à tous ce mode de vie (d’ailleurs biologiquement insoutenable pour notre planète). Les frustrations populaires s'aiguisent devant cette modernité, caractérisée par l'abondance dans la rareté. En réaction, des forces anti-systémiques se dessinent, même dans les pôles de prospérité. De Kananaskis, à Seattle Gènes et Honk Kong les conjugaisons de luttes diverses, pacifistes, écologistes, féministes, tiers-mondistes, alter mondialistes, anarchistes, communistes, socialistes et libéraux.. sont un panorama de plus en plus holistique de la contestation du mégaloensemble. Il faut bien sûr à présent dépasser l’incantation et la revendication pour des constructions d’alternatives.
Tentes
de manifestants altermondialistes la nuit au sommet OMC 2005 de Hong Kong. Photo
L’En dehors
Ailleurs dans bien d’endroits du Tiers monde, la même frustration et une sourde colère grondent. Mais aussi le désarroi, la quête de sens se manifeste par un retour du religieux et du culturel. Elles sont souvent des réponses inadaptées désespérées et anachroniques, mais surtout des désordres instrumentalisables par l'ennemi que l'on cherche à combattre.
Contre tout cela, la
repolitisation politique et démocratique des masses des pays non alignés, et
un nouvel élan d’unité et de solidarité démocratique seront essentiels.
Le redéploiement de l’hégémonie états-unienne hypothèque la paix mondiale, le développement et la démocratie. Modèle de la mondialisation, la société civile américaine, qui débat de croisade anti-terroriste, de guerre préventive et de bouclier sidéral, compte quelque 220 millions d'armes personnelles.
Les Européens tergiversent sur l’orientation de leur union en élargissement, sur les turbulences de leur portion Est, sur l’immigration et sur leurs politiques en remorque à l’hégémonie américaine.
Les Asiatiques s’insurgent contre la construction des bases militaires de Menoko, Okinawa et des Philippines et on observe en maints endroits la montée des tensions dues au nouveau pavage étatique de l’Asie (Afghanistan et autres anciennes républiques soviétiques).
Les Africains s’organisent de plus en plus massivement pour une justice économique, la démocratisation, mais aussi contre la cooptation des armées et rebelles dans des plans militaro-stratégiques de maintien d’une certaine paix. Ils luttent contre leur fausse marginalisation économique sur fonds de pillage de leurs ressources.
Les latino-américains, élisant de plus en plus de régimes progressistes, luttent contre un encerclement militaro financier des luttes populaires. Un encerclement maquillé en lutte anti-narcotique et en promotion du libre-échange tout azimut. Dans toute cette effervescence, partout la paranoïa sécuritaire et la rationalité marchande contribuent à instaurer un nouvel alignement économique et stratégique des pays du tiers monde devant le supra-impérialisme.
C’est donc contre cela que l’esprit de Bandoeng doit être revigoré. Afin aussi que les sociétés du Sud puissent lutter contre l’érosion de leurs valeurs de solidarité d’entraide et d’humanité[ix], si utiles au monde pour une autre mondialisation. Celle pour laquelle la nébuleuse alter mondialiste, qui a su synthétiser l’essentiel des revendications non-alignées, escompte le soutien de l’humanité, pour qu’elle lutte contre le risque de sa propre cooptation et mène à bien sa mission.
affiche zapatiste pour le forum social mondial de
Bamako
C’est pour cela que le paysan coréen Lee Kyung Hue s’est sacrifié en septembre 2003 à Cancun. C’est aussi contre une mondialisation prédatrice et l’unilatéralisme belliciste de grande puissance que s’étaient prononcés les non-alignés à Kuala Lumpur en février de cette même année. Lors de l’anniversaire du 50ème a été proclamé la déclaration pour nouveau partenariat Asie-Afrique.
Aujourd’hui, partout on semble reprendre conscience de l’ampleur des inégalités entre le Nord et le Sud. Probablement davantage depuis les attentats du 11 septembre, quand on sait comment la pauvreté et la frustration sont les terreaux de tels phénomènes. La renégociation en cours des rapports Nord-Sud est bien enclenchée. Mais dans les errements occasionnés par la mondialisation, elle n’est peut être pas suffisamment perceptible. Il y a, il est vrai, trop d’Etats qui sont docilement alignés. Soumission, compromission concussions. Des semi-périphéries requièrent toujours davantage de transferts de technologies du Nord, tout en s’autonomisant. Partout la réfection des codes miniers et l’arrêt des législations laissent en pâture des pans entiers aux multinationales.
Mais ce jeu n’en vaut pas la chandelle pour l’essentiel des populations, de plus en plus meurtries par ces ajustements. Ce n’est pas pour rien que l’impérialisme desserre l’étau de la dette. Il y a donc un réveil perceptible au sud. Il faut encourager les mouvements qui demandent un retour au non –alignement. Il faut insister sur la préservation des biens communs, un développement responsable, le démantèlement des bases militaires étrangères, une réforme en profondeur du système monétaire et multilatéral, et des règles plus équitables du marché mondial. Il faut arrimer davantage ces préoccupations aux mouvements internationalistes dans les pays du centre, afin de donner globalement une chance à un autre monde, et à un développement endurable!
Le Tsunami endeuille encore dans cette zone de naissance du non alignement le 50 ème anniversaire. Les 300 000 disparus et les millions de victimes y demeurent ceux qui étaient déjà les plus vulnérables. Le 21 février 2005, un glissement de terrain dans un bidonville de Bandoeng fait plus de 150 morts. Non loin de là où les décolonisés s’étaient donnés rendez-vous, pour proclamer leur liberté et leur développement, il y a 50 ans. Aujourd’hui une coopération internationale intéressée y capitalise de juteux contrats sur le terreau de l’humanitaire.
Mais la
condition infra humaine de ces populations de bidonvilles, jumelles de celles
d’Amérique latine et d’Afrique, vient nous
rappeler une chose. Ouvert à Bandoung, l’agenda de liberté, de
coexistence pacifique et de progressisme contre la barbarie, demeure toujours à
l’ordre du jour! Halo
Halo Bandoung!
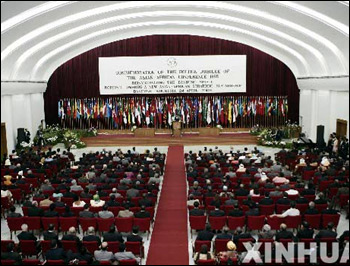
Vue de la salle de conférence célébrant le 50ème anniversaire le 24 Avril 2005
[i] Berg Eugène, Non alignement et nouvel ordre mondial, PUF, Paris, 1980, p22
[ii] titre de notre ouvrage en préparation
[iii] Alfred Sauvy, Trois mondes, Une planète, L’observateur, 14 Août 1952
[iv] Toussaint Eric, La politique du FMI et de la Banque mondiale à l’égard de l’indonésie entre 1947 et 2003, CADTM, 24 juin 2004, http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=709
[v] . Soekarno in Le Monde diplomatique, « Les objectifs de la Conférence de Bandoeng », mai 1955, p.1.
[vi] On relira les analyses prémonitoires de Samir Amin, Les défis de la mondialisation, l’Harmattan- Forum du Tiers monde, 1996, et de Michel Beaud, Le basculement du monde, la Découverte- Syros, 1997
[vii] Qui bien que formulé selon les exigences des grands bailleurs ne sera visiblement pas visiblement financé à la hauteur voulue
[viii] Elles fournissent de l’emploi à un peu plus de 72 millions de travailleurs, dont la moitié sont des emplois sous payés du tiers monde
[ix] Voir Anne Cecile Robert, L’Afrique au secours de l’occident, Les éditions de l’atelier-Ouvriéres, 2004
Aziz Salmone Fall
Politologue